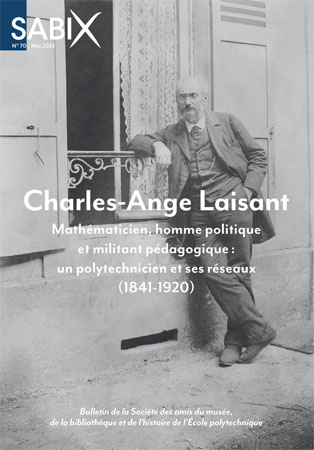B70 Charles-Ange Laisant Mathématicien, homme politique et militant pédagogique
10,00 €
Charles-Ange Laisant, né le 1er novembre 1841 à Indre, mort le 5 mai 1920 à Asnières-sur-Seine, est un militaire, un mathématicien et un homme politique français républicain radical, espérantiste, boulangiste dans les années 1880 et dreyfusard à la fin des années 1890, député de la Loire-Inférieure de 1876 à 1885 et de la Seine de 1885 à 1893. De 1893 à sa mort, sous l’influence de son fils Albert, il devient anarchiste.
Lors de la Première Guerre mondiale, il est l’un des signataires du Manifeste des Seize rassemblant les libertaires partisans de l’Union sacrée face à l’Allemagne.
Editorial
par Evelyne Barbin et Jérôme Auvinet
Introduction
par Evelyne Barbin et Jérôme Auvinet
I. Les réseaux du mathématicien Laisant : théories et collaborations
Charles-Ange Laisant au-delà de l’dentité polytechnicienne et des réseaux polytechniciens
par Jérôme Auvinet
Les liens entre Charles-Ange Laisant et Jules Houël entre 1870 et 1880 : les sociétés savantes, les hommes et les textes
par Frannçois Plantade
Charles-Ange Laisant « mosaïste » des Récréations mathématiques d’Edouard Lucas. L’exemple du « Jeu de Parquet »
par Lisa Rougetet
Une collaboration de Charles-Ange Laisant. L’algèbre et l’arithmétique graphiques de Gabriel Arnoux
par Évelyne Barbin et René Guitart
II. Les réseaux du mathématicien Laisant : pratiques et diffusion
Laisant et l’instrumentation mathématique
par Dominique Tournès
Les règlettes de Gennaille et Lucas (1885) … et quelques autres instruments
par Marc Thomas
Charles-Ange Laisant un mathématicien encyclopédiste par André-Jean Glière
Diriger un journal de mathématiques et y collaborer au temps de Laisant : le cas de la Nouvelle correspondance mathématique (1874-1880) par Norbert Verdier et Aurélien Gautreau
III. Les conceptions de Laisant sur l’enseignement et leurs diffusions
Le rôle privilégié de Charles-Ange Laisant au sein d’un réseau de professeurs engagés pour la promotion de l’enseignement de l’annalyse (1892-1905)
par Hervé Renaud
Philosophie et mathématiques chez Charles-Ange Laisant. L’enseignement de la géométrie comme science expérimentale
par Évelyne Barbin
S’initier à « la mathématique » avec Charles-Ange Laisant : manipuler, visualiser, s’étonner
par Marc Moyon
La diffusion des idées pédagogiques de Laisant au Brésil
par Circe Mary Silva da Silva et Maria Célia Leme da Silva
IV. L’engagement politique et internationaliste de Charles-Ange Laisant
Deux polytechniciens engagés dans leur temps : Charles-Ange Laisant (1841-1920) et Paul Guieysse (1841-1914)
par Yannick Marec
« Tout esprit libre est un agent de révolte ». Engagements pédagogiques et politiques de Laisant dans les années 1900
par Frédéric Mole
L’implication de Laisant dans le premier Congrès international des mathématiciens (Zurich, 1897)
par Rossana Tazzioli
L’Ensignment mathématique, un point d’orgue des engagements de Charles-Ange Laisant
par Jérôme Auvinet
Pourquoi ce numéro de la Sabix et, auparavant, un colloque international de l’université de Nantes ont-ils été entièrement consacrés à Charles-Ange Laisant ?
De manière factuelle, nous pouvons répondre qu’il y a d’abord l’écriture d’une thèse par un jeune chercheur nantais sur un polytechnicien du passé, né près de Nantes. Mais la suite tient surtout, en conséquence, à l’apparition dans l’histoire d’un personnage remarquable.
Il vit près de 80 ans dans une période riche en évènements qui résonnent encore de nos jours, englobant le second xixe siècle et allant jusqu’à la fin de la première guerre mondiale. Son parcours est particulièrement dense et diversifié. Il a été ingénieur militaire, homme politique, homme de presse, membre actif de sociétés savantes, enseignant et pédagogue, il est toujours resté mathématicien.
De plus, il a le souci et la volonté du partage : mathématicien, il fait connaître les théories des plus récentes ; pédagogue, il défend des conceptions nouvelles sur l’enseignement mathématique ; internationaliste, il participe à la création des premiers congrès et revues à l’échelle mondiale. Tant sur le point scientifique que politique, la solidarité est un moteur de ses actions.
Son personnage est attachant car toutes ses actions sont empreintes de sincérité et marquées par son intégrité. De plus, deux siècles après sa mort, ses écrits et ses actions font écho avec certaines préoccupations de notre temps, concernant aussi bien la recherche théorique, la recherche pratique, l’éducation et la société.
Laisant offre l’image d’un polytechnicien savant qui aime étendre ses investigations intellectuelles et ses réflexions sociales, et qui souhaite les diffuser par des actes publics auprès d’une audience la plus large possible. Il offre l’image d’un homme déterminé qui n’hésite jamais à s’engager, un homme d’action.
Il captive les historiennes et historiens qui se sont réunis pour travailler ensemble sur ses écrits et ses actes lors du colloque de 2021, mais l’écriture collective de ce numéro ne vise pas seulement leurs pairs. Ce numéro est écrit pour permettre aux lectrices et aux lecteurs de revivre l’existence passionnée de Laisant et, à travers lui, les espoirs d’une époque, mais aussi d’y trouver des ressources afin de réfléchir à leur présent et d’imaginer leur futur.
Jérôme Auvinet, docteur en histoire des mathématiques, chercheur bénévole au laboratoire de mathématiques Jean Leray (UMR 6629) de l’Université de Nantes et professeur en lycée.
Principaux thèmes de recherches : biographie du mathématicien Charles-Ange Laisant, réseaux de mathématiciens et revues mathématiques, mathématiques discrètes au XIXe siècle.
Évelyne Barbin, professeure émérite en épistémologie, histoire des sciences et des techniques au Laboratoire de mathématiques Jean Leray (UMR 6629) et à l’REM, Université de Nantes.
Principaux thèmes de recherches : histoire des mathématiques et de leur enseignement, histoires de la géométrie et de l’analyse, de la démonstration et des instruments.
Aurélien Gautreau, docteur en physique statistique appliquée à l’épidémiologie, enseignant en mathématiques à l’IUT de Cachan, chercheur associé au laboratoire d’tudes sur les sciences et les techniques de Paris-Saclay (UR EST).
Thèmes de recherche : histoire de la physique, des mathématiques, de l’enseignement, des périodiques scientifiques.
André-Jean Glière, professeur agrégé de mathématiques en classes préparatoires, a soutenu une thèse sur l’histoire et sur l’épistémologie des nombres négatifs en 2007.
Principaux thèmes de recherches actuels : intégrales et fonctions elliptiques à travers les correspondances de Legendre, Jacobi et Abel ; ouvrages sur le sujet de la seconde moitié du XIXe siècle.
René Guitart, mathématicien et philosophe, enseignant-chercheur de mathématiques à Paris 7 Denis Diderot jusqu’en 2012.
Thèmes de recherche : théorie des catégories, histoire des catégories, de la géométrie, de l’analyse, de la logique, de la théorie des modèles, des probabilités et de la théorie du potentiel, philosophies de Nietzche et de Bachelard.
Yannick Marec, professeur émérite d’Histoire contemporaine (Université de Rouen Normandie), docteur ès lettres et sciences humaines, président du conseil scientifique de la Société Française d’Histoire des Hôpitaux, vice-président du conseil scientifique du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale, ancien animateur à l’IREM de Rouen.
Frédéric Mole, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Jean-Monnet Saint-Étienne. Membre de l’unité de recherche Éducation, Cultures, Politiques (ECP).
Thèmes de recherche : histoire des idées et des controverses politiques en éducation au XXe siècle (syndicalisme, socialisme, éducation nouvelle …).
Marc Moyon, historien des mathématiques, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’Université de Limoges au sein de l’équipe MATHIS de l’institut XLIM (UMR 7252).
Thèmes de recherche : les mathématiques médiévales arabo-latines et l’histopire de l’enseignement des mathématiques élémentaires (XIXe – XXe siècles).
François Plantade, docteur en histoire des mathématiques, chercheur bénévole au laboratoire de mathématiques Jean Leray (UMR 6629) de l’Université de Nantes, membre de l’IREM Caen Normandie, professeur en lycée et à l’université.
Thèmes de recherches : biographie de Jules Houël, réseaux, revues, correspondances de mathématiciens au XIXe siècle, fonctions elliptiques et géométrie au XIXe siècle.
Hervé Renaud, docteur en histoire des mathématiques, professeur retraité du second degré, assure des enseignements d’histoire des mathématiques à l’Institut Catholique d’Enseignement Supérieur à La Roche-sur-Yon (85).
Domaines de recherche : enseignement secondaire de l’analyse en France au XIXe siècle, concours d’accès aux grandes Écoles.
Lisa Rougetet, maître de conférences en histoire des sciences à l’Université de Bretagne Occidentale, rattachée au Centre François Viète.
Ses recherches portent sur l’histoire des jeux et de leurs théories mathématiques, des premiers ouvrages de récréations mathématiques du xvii e siècle à la programmation des jeux sur ordinateur au XXe siècle.
Maria Célia Leme da Silva, docteure en éducation, professeure associée à l’Université fédérale de São Paulo, accréditée dans le programme d’études supérieures en éducation à l’Université Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, chercheuse à Ghemat, Brésil.
Thèmes de recherches : histoire de l’enseignement des mathématiques, enseignement de la géométrie.
Circe Mary Silva da Silva, docteure en pédagogie, professeure retraitée à l’Université fédérale d’Espírito Santo et professeure collaboratrice à l’Université fédérale de Pelotas, chercheuse à Ghemat, Brésil.
Principaux thèmes de recherche : histoire des mathématiques, histoire de l’enseignement des mathématiques, éducation scolaire indigène.
Rossana Tazzioli, professeure d’histoire des mathématiques à l’Université de Lille.
Ses principaux intérêts de recherche sont l’histoire de la géométrie différentielle aux XIXe et XXe siècles, le rôle des mathématiciens français et italiens dans la Grande Guerre, et l’histoire de l’Union Mathématique Italienne pendant le fascisme.
Marc Thomas, docteur en histoire des mathématiques, agrégé de mathématiques en retraite.
Principaux thèmes de recherche : histoire de la règle à calcul, instruments de calcul en particulier au XIXe siècle.
Dominique Tournès, professeur au Laboratoire d’informatique et de mathématiques de l’Université de la Réunion.
Ses travaux de recherche en histoire des mathématiques concernent l’analyse numérique, le calcul graphique, les équations différentielles et les mathématiques des ingénieurs dans la période 1750-1950.
Norbert Verdier, maître de conférences en histoire des mathématiques à l’Uiversité Paris-Saclay. Membre du laboratoire d’tudes sur les sciences et les techniques de Paris-Saclay (UR EST).
Ses principales recherches portent sur la presse mathématique et sur l’édition des mathématiques, au XIXe siècle.