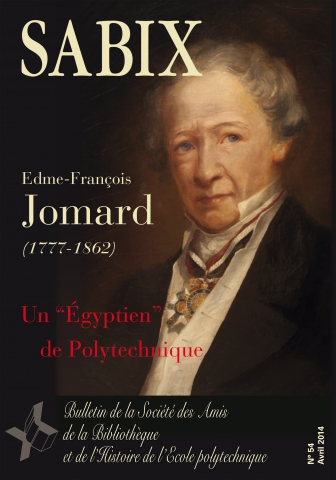Edme François Jomard (1777-1862). Un « Égyptien » de Polytechnique
20,00 €
Les historiens n’aiment guère les commémorations, dans lesquelles l’indépendance et la sérénité scientifique qui guident leurs travaux risquent de se trouver piégées par des enjeux politiques ou mémoriels. Ils en usent pourtant d’abondance, parce que ces moments attendus leur offrent tout à coup de brèves fenêtres de tir, ouvertes sur des possibilités matérielles de se rencontrer et de publier qu’ils recherchent souvent vainement, mais surtout sur un précieux horizon d’attente de la société dans son ensemble. Bien davantage que tout livre d’historien, ces manifestations sont aptes à réveiller une mémoire collective somnolente dont les cicatrices, réelles ou imaginaires, révèlent aussi parfois des douleurs vives, suscitant des débats annoncés ou imprévus.
À l’évidence, Edme-François Jomard (X 1794) échappe aux enjeux et aux risques du genre, car, hormis dans un cercle somme toute assez restreint, sa mémoire est évanouie depuis longtemps pour le public, au niveau national comme au niveau local. Le tour de force du colloque et des manifestations de l’automne 2012 a été de rendre à cet élève de la première promotion de ce qui n’était encore que l’École centrale des travaux publics, sise au Palais-Bourbon, sa place à l’École polytechnique de Palaiseau, mais encore, par une étonnante espièglerie de l’histoire, de lui rendre sa place dans la commune où il vint lui-même s’installer un siècle et demi avant l’École.
Pour les contributeurs au colloque « Jomard, le savoir et l’action », la question s’est posée en termes différents. Jomard peut-il être objet d’histoire et peut-on dire quelque chose de neuf sur lui, après la biographie magistrale qu’Yves Laissus lui a consacrée en 20041 ? Un colloque autour du personnage peut-il encore présenter un quelconque intérêt scientifique ? Chacun pourra en juger dans les pages qui suivent : certes, le champ était bien labouré et la production amplement suffisante pour la postérité, mais quelques sillons anciens recreusés à la recherche de nouveaux indices de l’activité inlassable et si diversifiée de Jomard méritaient sans doute de l’être. En tout état de cause, il était au moins possible, pour ceux qui ne le connaissent pas, de rappeler les aspects principaux de son œuvre, d’éclairer quelques aspects plus méconnus et d’interroger en quelque sorte leur descendance directe et collatérale. C’est l’objet de ce numéro.
Si la première partie (« Jomard et l’Égypte ») dépasse la personne de Jomard pour évoquer la longue histoire de l’Égypte contemporaine en quête de la modernité – nous allons y revenir – les deux suivantes portent sur d’autres formes parisiennes de son action d’infatigable militant du savoir, qui l’inscrivent pleinement dans son temps et donnent l’image fractale d’une œuvre qui se décline sous les mêmes configurations à quelque niveau que porte le regard. La deuxième partie (« Un polytechnicien dans le siècle ») présente la face publique non égyptienne de cette œuvre. Elle fournit un cadre intellectuel général dans lequel doit se comprendre aussi son action spécifique pour l’Égypte. L’importance des sociabilités savantes comme cadres de ces actions, en cette première moitié du xixe siècle, est le point commun des trois études retenues. Hélène Richard présente une utile synthèse de l’action majeure de Jomard dans le domaine de l’institutionnalisation des savoirs, la diffusion des sciences géographiques entre institutions publiques et sociétés savantes. « Le caractère multiforme et foisonnant de son activité et la cohérence de ses actions », qu’elle souligne dans sa conclusion, se retrouvent dans l’ensemble de son œuvre. Ils s’appliquent donc aussi bien à son action protéiforme à la Société d’encouragement pour l’industrie nationale face au défi britannique de la révolution industrielle sous la Restauration, qu’analyse Daniel Blouin, qu’à son action pour l’instruction publique, en particulier élémentaire, domaine pour lequel Renaud d’Enfert rappelle le fort investissement des polytechniciens, qui pourrait surprendre de nos jours. Enfin, dans la troisième partie, « Jomard à Lozère », Hervé Martin dévoile une face plus intimiste, qui donne à voir le savant déployant encore cette activité multiple à une échelle peu étudiée, sur le terrain de l’érudition locale, mais toujours parfaitement en phase avec les grands enjeux intellectuels du temps.