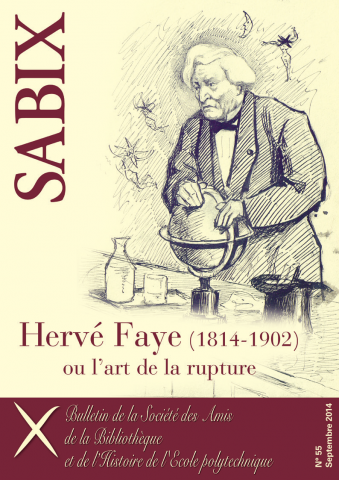Hervé Faye (1814-1902) ou l’art de la rupture
20,00 €
Éminent scientifique du XIXe siècle, Hervé Faye a reçu les plus hautes distinctions du monde académique et de la république. Il semble, toutefois, que son nom soit tombé dans l’oubli peu après sa mort à l’aube du XXe siècle. Son parcours, qui, selon le titre de la revue, est marqué par « l’art de la rupture », est pourtant emblématique de l’évolution de l’approche scientifique, notamment dans les sciences de l’Univers, au cours du siècle postrévolutionnaire. Cette dernière dimension rend d’autant plus louable, à l’approche du bicentenaire de la naissance d’Hervé Faye, l’initiative du Centre François Viète consistant à rassembler des experts reconnus en matière d’histoire des sciences afin de mettre en perspective la démarche d’Hervé Faye et son impact scientifique, institutionnel et sociétal.
L’ouvrage qui résulte de cette initiative fait apparaître les multiples dimensions de l’action d’Hervé Faye : pluridisciplinarité scientifique, transmission du savoir par l’enseignement et la diffusion des connaissances auprès du public, engagement politique. Ce large spectre d’activités, partagé avec ses illustres contemporains François Arago et Urbain Le Verrier, est d’une certaine manière une caractéristique des scientifiques de cette époque.
La pluridisciplinarité d’Hervé Faye, c’est non seulement l’abord de domaines très variés, de la découverte d’une comète à la géodésie et la météorologie en passant par la physique solaire et la cosmogonie, mais aussi l’approche observationnelle, métrologique et théorique, et enfin le développement scientifique au service de la société.
Transmettre le savoir est un souci constant d’Hervé Faye. Il s’en acquitte par les canaux académiques de l’École polytechnique ou de l’Université de Nancy mais également auprès du grand public en faisant renaître les notices scientifiques de l’Annuaire du Bureau des longitudes en digne successeur de François Arago qui s’en était chargé pendant de longues années.
Le scientifique du XIXe siècle est souvent proche, par nécessité, du politique. C’est ainsi qu’Hervé Faye obtient directement auprès de Mac Mahon l’installation du Bureau des longitudes dans les locaux de l’Institut de France. De même il défend pendant plus de trente ans l’idée d’unifier le temps de l’hexagone, ce qui aboutit à l’adoption d’une loi en la matière en 1891. Il est enfin un ministre éphémère de l’instruction publique, des cultes et des beaux-arts en 1877.
Le parcours d’Hervé Faye, apparemment marqué par de nombreuses ruptures, semble se stabiliser lorsque, à 48 ans, il devient membre du Bureau des longitudes. Il joue ensuite pendant près de quarante ans un rôle essentiel dans l’évolution du Bureau des longitudes dont il assure la présidence pendant plus de vingt ans. En effet, le Bureau des longitudes, après une période faste marquée par la mise en place du système métrique décimal et l’action de François Arago, s’est trouvé affaibli après avoir été séparé de l’Observatoire de Paris par Urbain Le Verrier, pourtant membre de ce même Bureau. Hervé Faye entre en quelque sorte en résonance avec les orientations fondamentales du Bureau des longitudes qui ont été fixées à cet organisme notamment dans le rapport de l’Abbé Grégoire fait à la Convention nationale dans sa séance du 7 messidor an III (25 juin 1795). Quelques extraits de ce discours soulignent ces orientations. Il y est tout d’abord indiqué que « le Bureau des longitudes, par ses travaux, ses observations et la correspondance avec les savants, tant nationaux qu’étrangers, rassemblera en un faisceau toutes les lumières propres à éclairer et à diriger la navigation extérieure ». Le rapprochement entre science fondamentale et évolution des concepts, économie et diplomatie est mentionné explicitement : « La découverte des satellites de Jupiter, en perfectionnant les cartes marines, a suffi pour produire une révolution dans l’esprit humain et dans les relations commerciales et diplomatiques ». Quant à l’éventail des disciplines nécessaires pour résoudre le problème des « longitudes », l’Abbé Grégoire fait état de ce que « l’Horlogerie, la Mécanique, la Géométrie, l’Astronomie se sont disputé la gloire de résoudre ce problème, toutes se sont assuré des droits à la gratitude des nations. Tandis que l’Astronomie perfectionnait ses méthodes pour mesurer les distances de la Lune au Soleil et aux étoiles, ce qui lui donne la différence des méridiens, l’Horlogerie exécutait les montres marines, dont l’idée n’était pas neuve, mais dont l’application l’était ». Le rapport fixe un dernier objectif : « Le Bureau des longitudes s’occupera également de la Météorologie, science peu avancée, et cependant les résultats de cette branche des connaissances humaines importent singulièrement à l’Agriculture.
On sait avec quel succès ils ont été appliqués par Duhamel à la Botanique, par Malouin à la Médecine, par Deluc à mesurer la hauteur des montagnes ».
On retrouve dans ces lignes directrices les éléments caractéristiques de la démarche d’Hervé Faye : un large éventail de disciplines, l’appropriation de nouvelles techniques, la mise en réseau des scientifiques, la recherche d’applications au bénéfice de la société. C’est ainsi qu’il s’approprie la photographie au profit de l’astronomie et le télégraphe au profit de la détermination des longitudes. Il joue également un rôle essentiel dans l’implantation, de concert avec l’Amiral Mouchez, d’un observatoire au parc Montsouris dédié à la formation des marins. Il est enfin très impliqué dans le développement de la géodésie au niveau national et international.
Henri Poincaré a dit d’Hervé Faye : « c’est un semeur d’idées ; c’est par là avant tout que sa mémoire vivra ». Il ne fait pas de doute que cet ouvrage très bien documenté permettra à la mémoire de se réveiller !