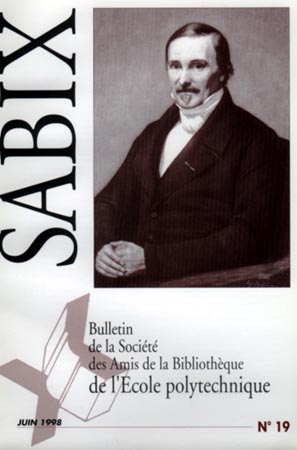B19 Jean-Victor Poncelet (1788-1867)
10,00 €
- Quelques réflexions à l’occasion de son cours inédit à la Sorbonne
En juin 1987 Emmanuel Grison signait l’éditorial du premier bulletin de la SABIX consacré, pour l’essentiel, à la « Description d’Egypte » (ce bulletin est aujourd’hui introuvable). En juin 1998 c’est un président de la SABIX en partance – fin de mandat non renouvelable -qui écrit ces quelques lignes.
Notre association vient de fêter son douzième anniversaire ; il ne m’appartient pas de dresser un bilan de cette période. Je me contenterai de faire un simple constat : notre association se porte bien et sa réputation, dit-on, est bonne.
Christian Marbach a été élu président du Conseil d’administration de la SABIX au mois de juin. Il est connu de vous tous : chacun se souvient qu’il a su donner à la commémoration du bicentenaire de l’Ecole l’éclat souhaitable et le ton juste. Je sais qu’il apportera beaucoup à notre association et mes vœux les plus amicaux l’accompagnent.
4L’expérience de ces quelques années m’a montré que la SABIX avait une marge de développement très considérable. Les réunions du conseil ou du bureau montrent qu’il y a pléthore d’idées d’actions possibles et souhaitables, que les sujets intéressants situés dans le champ d’action de la SABIX sont légion : bénéfiques pour l’Ecole, pour notre communauté et plus généralement pour l’histoire des sciences et des techniques. Les obstacles rencontrés, les difficultés qui expliquent que telle idée ne s’est pas encore concrétisée, contrairement à ce que certains pourraient penser, ne sont pas toujours de nature matérielle, manque de moyens financiers, par exemple. Pour l’essentiel les obstacles sont intellectuels, les difficultés sont humaines. Valider une idée, construire un projet exige un investissement personnel : visites, lectures, entretiens, réunions, négociations, préparation d’argumentaires, etc. J’en veux pour preuve que depuis douze ans, je n’ai pas eu connaissance d’un projet de la SABIX qui n’aurait pas pu aboutir par manque de moyens matériels, par manque d’argent. Ce dont l’association a le plus besoin c’est de bénévoles : des animateurs passionnés, prêts à prendre de leur temps et de leur intelligence pour développer des projets.
Cet ultime éditorial me donne l’occasion de lancer à nouveau un appel aux bonnes volontés potentielles qui pourraient venir renforcer le noyau trop réduit de fidèles qui font aujourd’hui marcher la SABIX. A ceux qui se décideraient à nous rejoindre, je peux donner une double assurance : ils seront accueillis dans une ambiance amicale, ils pourront s’investir dans des activités qui très vite les passionneront.
Dans l’éditorial du bulletin numéro 17 j’avais évoqué, à propos du fonds Danzin (X 39) le problème des archives techniques et industrielles auxquelles la SABIX s’est intéressée et qui constituent, pour la communauté polytechnicienne, un champ très vaste encore beaucoup trop peu défriché aujourd’hui. J’avais reporté à plus tard de revenir sur ce que l’on pourrait appeler, dans le jargon de notre époque, notre « cœur de métier », à savoir les fonds proprement scientifiques.
Les fonds de l’Ecole sont surtout connus, notamment à l’étranger, pour ce qui nous vient d’un passé déjà lointain : les Lumières, la Révolution, les premières décennies du XIXe siècle. Bien sûr il faut continuer à accorder à l’âge d’or de l’Ecole polytechnique une attention soutenue : restaurer (bien des documents anciens ont été beaucoup consultés), enrichir (des pièces d’époque surgissent encore parfois ici ou là qu’il ne faut pas laisser partir), mettre en valeur, etc. Mais ce serait une grave erreur de ne pas apporter une attention soutenue aux époques ultérieures : la suite du XIXe siècle et le XXe siècle.
Certes la France n’est plus avec l’Angleterre au cœur du progrès de la science et des techniques comme elle le fut au XVIIe, XVIIIe et au début du XIXesiècle. De nouvelles nations émergent, puissantes et dynamiques, le Monde se dilate sans cesse. Aujourd’hui où l’on essaie de tout quantifier, on estime que la France contribue à moins de 10 % aux progrès de la Science et de la Technique. Il faut ajouter qu’en France l’Ecole polytechnique ne joue plus le rôle principal, comme lors de sa naissance et dans les premières décennies de son existence. Pourtant, ce n’est pas la fin de l’Histoire – ni pour l’Humanité, comme certains ont cru pouvoir le dire – ni pour l’Ecole polytechnique !
L’Ecole conserve un rôle important dans la recherche scientifique française : on peut même parler d’un renouveau depuis le deuxième guerre mondiale. Mais surtout, de nombreux polytechniciens ont continué à développer les branches les plus diverses de la connaissance et du savoir, conformément à leur mission. Cette singularité – qui a ses vertus mais aussi ses inconvénients – est sans équivalent ailleurs, en France ou à l’étranger. Elle fait de l’Ecole une « exception culturelle » qui ne laissera pas indifférents les historiens à venir. Il serait bon aussi de se souvenir que les polytechniciens ont exploré des sciences autres que les sciences de la nature : d’Auguste Comte à Alfred Sauvy ou Jacques Rueff, pour ne pas évoquer les vivants ! Le devoir de mémoire nous demande de tout faire pour que les archives correspondantes ne disparaissent pas dans le grand souffle de la mondialisation, de la société de l’information et de l’univers virtuel !