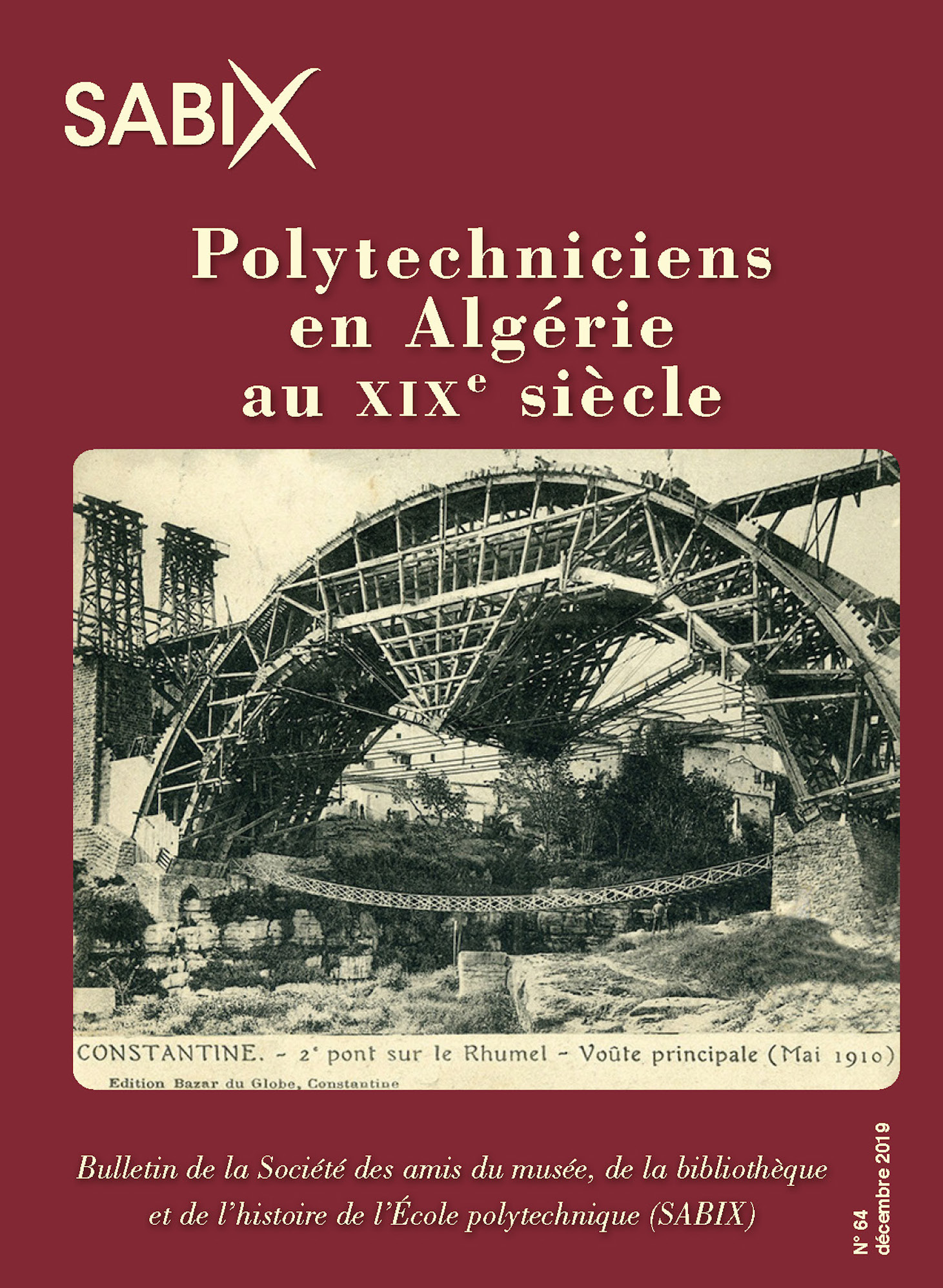B64 Polytechniciens en Algérie au XIXème siècle
10,00 €
Ce bulletin est dédié à une période mal connue de l’histoire de l’Algérie : celle qui va de sa conquête par la France à partir de 1830 jusqu’aux débuts de la Première Guerre mondiale. Le nombre d’X qui y ont œuvré est loin d’être négligeable : l’analyse de la banque de données « Famille polytechnicienne » a mis en évidence 257 membres des promotions avant 1914 qui sont nés ou ont servi en Algérie1 ; et encore cette liste est-elle incomplète, maintes personnalités évoquées dans ce bulletin n’y figurant pas2.
Le choix fait par les coordinateurs du numéro a été d’examiner cette population assez nombreuse en se focalisant sur quelques « cas d’études » : après un premier article consacré à « L’institutionnalisation de l’astronomie française en Algérie », chacun des six suivants est dédié à un polytechnicien remarquable, ayant exercé une activité scientifique parallèlement à son activité administrative ou militaire.
Ces articles sont complétés par un riche cahier d’illustrations, regroupant des lettres, photos et publications issus des archives de l’École polytechnique, ainsi que du fonds Catalan à l’université de Liège. Ces documents donnent une image particulièrement vivante de la vie et de l’activité en Algérie de sept autres polytechniciens, ainsi que de la communauté des mathématiciens.
Bien que les articles composant ce bulletin soient centrés sur le destin algérien d’un petit nombre de polytechniciens, c’est plusieurs centaines d’individus remarquables que l’on croisera au fil des articles, dont 112 X, allant de la promotion 1799 (François Bergé) à la promotion 1899 (Eugène Freyssinet). Leurs noms sont regroupés dans l’index général figurant à la fin de ce numéro3, qui indique les articles où leurs noms sont cités. Certains de ces noms apparaissent jusque dans quatre articles différents, témoignant de l’importance des contributions, mais aussi, souvent, de la variété des centres d’intérêt et de l’entrecroisement des destins.
L’échelonnement dans le temps des exemples choisis permet de mesurer l’évolution du pays sur la période. Celui-ci parait presqu’inconnu lors de l’expédition de juin 1830. Le comte de Bourmont, ministre de la Guerre de Charles X, peut alors s’étonner que « une expédition aussi importante […] ait été entreprise avec les renseignements les plus incertains et les plus incomplets. »4. La situation semble n’avoir guère changé une quinzaine d’années plus tard, et Henri Fournel peut écrire : « Il est très vrai que j’ai publié deux ouvrages sur l’Algérie après un séjour de quatre années (1843-1846) dans cet intrigant pays sur lequel on savait si peu de choses. »5 Mais vers 1870, le pays apparaît bien connu et administré, ainsi qu’en témoigne la « Carte administrative de la Kabylie » figurant dans l’article d’Othman Salhi. Il est également doté d’infrastructures ferrées et portuaires modernes7, mais n’en reste pas moins sauvage dans certaines zones : en 1892 encore, Albert Ribaucour signale dans une lettre, qu’on avait tué une panthère en Haute Kabylie…
Mais quelle a été la contribution des polytechniciens à ces évolutions ? Elle a été bien sûr principalement militaire au cours des premières années. Trois exemples en sont donnés dans le cahier d’illustrations : nous croisons tout d’abord la grande figure de Stanislas Marey-Monge (X 1814), créateur et commandant des spahis, arabisant, ami d’Abdelkader dont il traduisit les poésies.9 La situation semble bien pacifiée en mai 1879, quand le capitaine d’artillerie Marius Ernest Laquière (X 1858) professe un cours théorique à l’École régionale de tir de Blida.10 Mais ce calme n’est qu’apparent, et l’intérieur du pays reste peu sûr, comme en témoigne la « randonnée dans le vrai bled », plutôt mouvementée, relatée en mai 1908 par Georges Favereau (X 1886) dans une lettre adressée à son camarade de promotion Arthur Dumas.11 Il faut souligner le grand respect manifesté par Favereau pour « la ténacité de l’ennemi et sa façon très judicieuse de combattre et d’utiliser le terrain ».
Ce respect pour le pays et sa culture peut aller jusqu’à une véritable passion, comme c’est le cas pour le général Adolphe Hanoteau12, auteur des premières grammaires des langues berbères, et pionnier de la sociologie et de l’ethnographie avec son monumental ouvrage « La Kabylie et les coutumes kabyles » coécrit avec Aristide Letourneux.
Mais peu à peu, l’occupation militaire laisse la place à une administration civile, en même temps que le poids des colons s’accroit. Un exemple est l’institutionnalisation de l’astronomie en Algérie, analysée par Frédéric Soulu, où l’on voit des observatoires « en dur » succéder aux établissements provisoires créés par les militaires, avant qu’ils ne s’intègrent dans une institution : l’Observatoire d’Alger.
Bien entendu, l’adaptation au contexte local ne va pas de soi, et les polytechniciens doivent mobiliser tout leur savoir pour imaginer des solutions créatives aux problèmes rencontrés. Cela se traduit parfois par de véritables avancées scientifiques, comme pour Auguste Bravais qui développe une méthode statistique nouvelle pour « décrire avec le plus de précision possible les côtes algériennes sans jamais ou presque y aborder vraiment », comme le formule Bernard Bru au début de son article13.
En retour, les connaissances accumulées en Algérie peuvent être utilisées pour expliquer des phénomènes observés en Europe : c’est ce qui permet à Harold Tarry d’avancer l’hypothèse que les pluies de sables dans le sud de l’Italie résultent d’un mouvement d’oscillation des cyclones entre l’Europe et l’Afrique. Tout à la fois météorologue, astronome, archéologue et mathématicien, ce véritable polygraphe, évoqué par Evelyne Barbin, fait preuve d’une polyvalence et d’un enthousiasme impressionnants !
Sans atteindre une telle versatilité, beaucoup de polytechniciens en poste en Algérie arrivent à poursuivre une activité scientifique de bon niveau parallèlement à leur travail d’ingénieur : par exemple, le nombre de publications d’articles de mathématiques est tout à fait remarquable. Certes, tout cela était avant la professionnalisation des activités de recherche, et un ingénieur des Ponts et chaussées tel qu’Albert Ribaucour pouvait faire des contributions décisives en matière de géométrie différentielle, tout en pilotant la construction d’ouvrages d’art importants : voie ferrée Béjaia-Béni Mansour, « quai Ribaucour » au port de Béjaia, etc.
Bien sûr, une affectation en Algérie présentait certains inconvénients, notamment l’éloignement des réseaux scientifiques et politiques de la métropole, ainsi que cela apparaît dans le cas de Charles-Ange Laisant (X 1859), étudié par Jérôme Auvinet.16 Cela n’en restait pas moins un choix très prisé, en permettant probablement un accès rapide aux responsabilités et une certaine indépendance, autorisant l’expérimentation de solutions innovantes. Bien qu’étant resté moins d’un an en poste en Algérie, Laisant fait ensuite des efforts considérables pour implanter dans sa région une organisation inspirée des services météorologiques algériens dont il avait pu apprécier l’efficacité. En outre, une affectation même brève en Algérie permettait semble-t-il d’entrer dans un réseau de personnalités de valeur.
Le dernier « cas d’étude » de ce bulletin, présenté par Djamil Aïssani et Mohamed Réda Békli, revêt un caractère tout particulier : il est consacré au premier polytechnicien algérien, Chérif Cadi (X 1887). Issu d’un milieu modeste, celui-ci est devenu, suivant ses propres termes « polytechnicien, ingénieur et astronome, enfin officier supérieur de l’artillerie française. » Un bel exemple d’ascenseur social et de promotion républicaine, qui est malheureusement resté exceptionnel au cours de la période examinée.17 On se plait à imaginer ce qu’aurait pu être le destin de la France et de l’Algérie si de tels exemples s’étaient multipliés, dans la ligne de l’ouverture culturelle manifestée par des personnalités telle que Marey-Monge ou le général Hanoteau… mais cette question échappe au champ de ce bulletin.