



Où l'auteur brosse la noble figure du général Simon Bernard : un soldat et un bâtisseur. Comme promis, il est amené à insister sur la partie américaine de sa carrière, de 1816 à 1830, et n'oublie pas de le suivre dans les bayous de Louisiane.
C'est à Dole, 39100 - DOLE, qu'est né Simon Bernard. J'aime bien cette petite ville du Jura. J'y ai des amis qui m'en ont fait connaître les vieilles rues et les monuments - les bonnes adresses pour acheter du comté - aussi. La collégiale Notre-Dame avec ses marbres et son orgue domine la cité de son « puissant clocher », dixit le Guide vert. Les maisons anciennes offrent cours, tourelles, escaliers, blasons. La nouvelle médiathèque (nouvelle dans l'organisation mais vénérable dans l'architecture) propose avec précision un supplément de culture à ceux qui le souhaitent ; le port, parfois enneigé, parfois ensoleillé, offre aux amateurs des péniches de location pour parcourir le Doubs ou les canaux. A moins de vingt kilomètres, en traversant la forêt de Chaux jalonnée encore de quelques colonnes de pierre dues à Ledoux, on peut rejoindre la Saline royale d'Arc-et-Senans, cité idéale propice aux réflexions sur les cités idéales : c'est là que j'ai commencé à m'instruire sur ce sujet que j'ai abordé dans notre chapitre V.
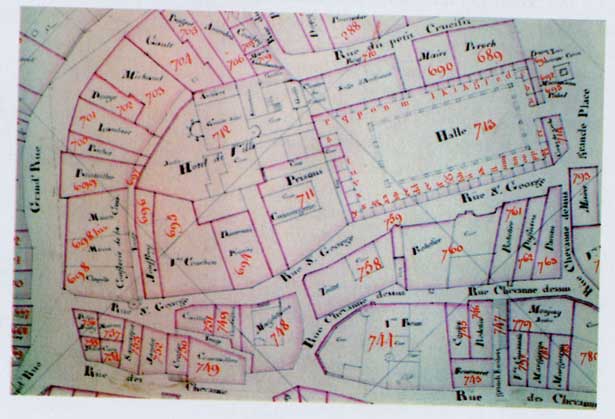
Si je vous parle de Dole (sans accent circonflexe, j'y insiste - même si des dizaines de journalistes coiffent son nom de ce chapeau incongru quand ils y viennent à l'occasion d'une étape du Tour de France ou d'une joute électorale), c'est donc à cause de notre Simon Bernard, gloire locale ou célébrité discrètement inconnue. Il y a une rue (celle de sa maison natale, mais je suis prêt à parier que moins de 1% des Dolois savent qui est ce Bernard). Il y a un buste, dans la mairie - un beau buste, en vérité. Une caserne portait son nom, je suis heureux que le dernier responsable de ce casernement ait écrit sur Bernard un livre intéressant, plus facilement disponible que la thèse que j'ai citée, aussi, au début de cet essai. Le tableau de Bernard qui était suspendu dans cette caserne est parti dans les locaux centraux de l'Ecole du Génie, à Angers, me dit le lieutenant colonel Scaggion. Un autre tableau, en pied et en grand uniforme et toutes décorations affichées (est-ce une autre version du même ?), dû au peintre Edouard Baille, figure au Musée du Temps, à Besançon : c'est lui que reproduit l'ouvrage sur les relations entre l'Ecole Polytechnique et les Etats-Unis, avec un article de Claudine Billoux.

Mais les ouvrages touristiques faisant la liste des « grands » enfants de Dole, ou a fortiori des grands hommes de la Franche-Comté oublient ce soldat. Bien sûr, ils évoquent Pasteur, ce recordman des images d'Epinal pour vocations scientifiques (et des effigies philatéliques, voir notre bulletin SABIX, numéro 36) : sa maison natale est bien aménagée en musée. Ils citent Marcel Aymé, qui y résida longtemps et en utilisa les recoins dans ses romans. Ils vont jusqu'à raconter qu'un Dolois, général, contemporain de Bonaparte (lui aussi) fomenta une conspiration pour se débarrasser de l'Empereur, tentative lamentable conclue par une condamnation à mort expéditive. Mais pourquoi donc, tant qu'à citer un général d'Empire, ne pas plutôt citer Bernard qui dut avoir honte de ce Malet ?
(Et, puisque j'en suis à rendre à la lumière de la renommée des enfants illustres de Dole, je vous signale aussi un très bon peintre, prénommé Simon lui aussi, Simon Bussy. Ses tableaux animaliers, personnages d'un bestiaire très début XXème, connaissent une cote grandissante dans les salons et les expositions, ses oiseaux sont nettement plus stylisés que ceux d'Audubon et n'ont pas de prétention scientifique mais traduisent une autre approche du rendu des expressions et des mouvements : fin de la parenthèse Bussy).
Simon Bernard est né à Dole, donc, en 1779. La médiathèque de la ville a conservé quelques documents le concernant, mais l'essentiel des archives relatives à son séjour américain se trouve aux Etats-Unis, à la « Library of Congress ». Françoise Planchot-Mazel les a utilisées , croisées avec les documents de nos Archives Nationales, pour l'excellente thèse qu'elle a soutenue en 1988 à la Sorbonne sous le titre : « Un général français aux Etats-Unis, Simon Bernard ». Cet ouvrage est très documenté ; il figure dans le dossier d'Ecole de notre Bernard, à côté de quelques notices biographiques brèves, celle du Livre du Centenaire ou celle de notre Callot ; à côté aussi de la reproduction complète du discours d'adieu prononcé après la mort de Bernard par son ami, le ministre - comte Molé ; à côté enfin de copies de prospectus et notules distribués aux visiteurs du Fort Monroe, le « Gibraltar de la baie de Chesapeake », bâti sous les ordres de Bernard entre 1819 et 1834 et visité aujourd'hui par les touristes virtuels sur le NET ou les touristes réels aux Amériques : si vous y allez, vous trouverez un autre exemplaire du tableau « en pied » ainsi que la copie du buste dolois, offert aux Etats-Unis en 1959 par la municipalité franc-comtoise, trônant dans ce musée qui est, presque, un « musée Simon Bernard ».
Simon Bernard, même peu connu... à Dole, l'est donc ailleurs, et pour beaucoup de bonnes raisons, une carrière exemplaire de soldat, d'abord - de bâtisseur, ensuite ; d'homme d'Etat, enfin, polytechnicien de la toute première promotion, soldat de l'armée du Rhin, en poste sur tous les champs de bataille y compris la lointaine Illyrie, bref une carrière classique sous l'il attentif de l'Empereur qui en fait son aide de camp. Encore des campagnes, la Russie, Leipzig ; encore des blessures, et des sièges à Anvers, enfin la première abdication.
Bernard vécut la première Restauration dans l'inconfort, il eut du mal à y faire valider une nomination au grade de général de brigade décidée par Napoléon dans ses derniers jours de règne. Mais voilà que sa réclamation est admise, Louis XVIII y ajoute même une décoration...patatras, l'Empereur revient de l'île d'Elbe, et notre Bernard se précipite à son service, l'accompagne dans ses campagnes, le protège à Waterloo, y devient le messager de la mauvaise nouvelle (c'est lui qui dit à Napoléon, « Sire, ce n'est pas Grouchy, c'est Blucher »), et de nouveau la fuite, jusqu'à Rochefort, Bernard va jusqu'à solliciter une place dans la petite escouade destinée à partir en mer (on sait que ce ne sera pas vers les Etats-Unis, mais vers Sainte-Hélène), il n'est pas sélectionné pour cette épreuve, et se trouve donc à nouveau contraint de faire allégeance au Roi. Le Livre du Centenaire commente avec sagesse ces pas de soldat... ou de clerc : « de telles variations de conduite, se succédant à de si courts intervalles, surprennent ceux qui n'ont point vécu dans les temps troublés. On en voit des exemples chez les hommes de l'esprit le plus indépendant. Et ce n'est pas faiblesse de caractère : c'est que, étrangers aux intrigues des partis, regardant le service du pays comme un devoir supérieur à la fidélité due aux gouvernants, même à leurs préférences et à leurs affections personnelles, ces hommes se croient obligés de se consacrer à lui, quel que soit le chef qui préside à ses destinées. Le général Bernard avait prouvé sa valeur et son dévouement à la France par dix-huit ans de travaux, accomplis sans interruption. Mais ceux qui ne le connaissaient pas pouvaient concevoir des craintes, à une époque où tant de complots menaçaient l'existence d'un pouvoir encore mal assis. Le général Bernard songea à s'expatrier, à chercher hors de France l'occasion d'employer ses connaissances si étendues et son activité. Le général de Lafayette, qui avait conservé de grandes relations aux Etats-Unis, lui servit d'intermédiaire. Ce fut avec une autorisation spéciale du Roi, sous la réserve de continuer d'appartenir au corps du Génie français, de figurer sur les contrôles, et de conserver la faculté de reprendre du service dans ce Corps, lorsqu'il quitterait celui des Etats-Unis, que le général Bernard passa en Amérique. C'est dans ces termes honorables que l'autorisation royale lui fut accordée le 2 septembre 1816 ».

Voici donc Bernard aux Etat-Unis, s'installant dans son poste de brigadier général de l'armée fédérale malgré les manuvres de certains collègues américains : se sentant supplantés, ne pouvant mettre en avant une compétence supérieure, ils cherchèrent à répandre le soupçon sur l'éventuelle loyauté de Bernard en cas de conflit (entre qui et qui, mon Dieu ! certainement pas contre les Anglais). Pourquoi ne pas le « limiter » ou « l'élever » à des prestigieuses fonctions d'enseignement ? On sait comment Bernard évita la manuvre en avançant le « pion » Crozet. Le président Madison, qui a pu évaluer la faiblesse des fortifications de son pays pendant la guerre de 1812, s'obstina de son côté, imposa Bernard quitte à recevoir et accepter certaines démissions d'officiers américains, et voici notre Dolois au travail : relevés topographiques, plans et analyses de voies de communications, projets de fortifications, choix d'emplacements pour plus de deux cents forts, organisation de leur édification avec choix des plans mais aussi des techniques adaptées aux terrains et aux matériaux : le « Vauban du Nouveau Monde » laissera sa marque d'ingénieur-soldat dans de nombreux Etats de l'Est américain.
J'ai déjà mentionné ses contacts fréquents avec le prince Joseph ; l'aide reçue de Poussin ; les relations nombreuses avec Lafayette, auquel il écrira souvent, et qu'il rencontrera bien sûr lors de son triomphal Tour des Etats-Unis de 1824-25 (La Fayette pourra constater combien il eut raison de recommander Bernard à ses amis américains). Je vais maintenant voyager avec lui en Louisiane.
Le premier voyage de Bernard en Louisiane eut lieu dès mars 1817 - c'était une sorte de test ou même de bizutage d'accueil dans la mesure où un tel déplacement était encore, à cette époque, une entreprise longue, dangereuse, et dans les terres mal reconnues en dehors du grand axe du Mississippi ou de la voie maritime côtière. Bernard, pour son premier déplacement vers le Sud, passa par la mer ; d'autre fois , il empruntera la voie terrestre, Baltimore, Pittsburg, le bateau sur l'Ohio puis le Mississippi, les « steamboats » n'étaient alors guère nombreux et de nombreux voyageurs, comme Audubon, iront jusqu'à louer ou acheter leur propre embarcation quitte à redouter les pirates plus ou moins organisés pour le vol ou le « racket ».
Bernard, donc, part en Louisiane avec ses appareils cartographiques pour ses relevés et ses mesures. Le fidèle Poussin lui tient compagnie, mais aussi deux ou trois officiers américains égarés dans le « french bashing » sans raison objective (c'est d'autant plus vexant, une supériorité technique ou intellectuelle chez quelqu'un dont vous devez constater les travaux et les résultats). Bernard, indifférent en apparence aux contre lettres adressées par ses « aides », travaille, dicte à Poussin ses rapports, se félicite des croquis que son aide de camp y ajoute, dessine la Louisiane, actuelle, et future.
Quand il est arrivé en mai 1817 à la Nouvelle Orléans, cette ville, nous le savons déjà est à la fois superbe et sordide. Comme beaucoup de voyageurs, Bernard descend à l'hôtel Tremoulet, où logent alors une vingtaine d'officiers bonapartistes qu'il connaît bien, dont Lallemand, qui prépare le Champ d'Asile, dont Lefebvre-Desnouettes, dont bien d'autres perdus dans la nostalgie de leurs souvenirs, ou dans l'irréalité de projets incertains, comme l'enlèvement de Napoléon.
Bernard fuit ces discussions, il a trop à faire, et sa position encore contestée (il en souffre tous les jours) l'oblige à une prudence qui convient à son caractère. Il ne veut pas rater son intégration dans l'armée américaine. Il se consacre donc avec un acharnement qui vainc mille difficultés à la reconnaissance des bouches du Mississippi : « ce monde aquatique de forêts noyées et de marécages où se mélangent lacs, bras de rivières, et où pullulent alligators, serpents, insectes et oiseaux de toutes sortes ». A cheval, à pied, en bateau à fond plat (le Keelboat), sous une chaleur moite qui vous enfièvre, il transporte ses instruments et dresse ses cartes, avec une minutie digne d'éloges : il s'agira souvent des premières cartes jamais dressées dans certaines contrées. Il envoie son rapport final le 23 décembre, en cadeau de Noël, à Madison et y émet de sérieuses réserves sur le système de fortifications. Comme l'Espagne occupe toujours la Floride, il traite le problème de la protection militaire de la Nouvelle Orléans en tenant compte autant du terrain que des populations qui y habitent, et de son éloignement avec les bases arrière plus sûres du Tennessee : une campagne militaire (il en évoque des scénarios) n'est pas seulement affaire de relief et de climat. Pour en rendre un éventuel déroulement plus sûr, il propose donc une remise en état des anciennes fortifications et la construction de nouvelles.
Un très beau « dossier », donc, un rapport préliminaire à l'action dressé en quelques mois. On y trouve, mêlés, des traits qui tiennent à Simon et des traits qui tiennent à l'enseignement polytechnique - sans oublier, cela va de soi, l'expérience accumulée à construire ou combattre des dizaines d'autres forts sur tous les terrains de campagne de l'Empire. Bernard est « humble » : pas d'impasse sur les données inconnues, on les cherche ou on avoue les ignorer en suggérant comment se les procurer. Il est « pertinent », rassemblant ce dont il a besoin et ce dont les futurs acteurs pourraient avoir besoin. Il est certes ambitieux mais avec économie, proposant des progrès incrémentaux quand c'est possible, définissant les moyens nécessaires, presque les budgets et toujours la durée de réalisation. Il est technologue, attentif par exemple à ne pas recommander dans des sols gorgés d'eau les matériaux et les modèles de construction utilisés en Europe. Il est, bien sûr, géomètre aussi : nous savons que la discipline des fortifications fut enseignée à l'X avec attention et précision, à la lisière entre les mathématiques et l'art de la guerre, cousine de la géométrie descriptive de notre cher Monge - de leur cher Monge, cher à Bernard et à Crozet.
La vie « américaine » de Bernard comprendra de nombreuses autres expéditions, tantôt vers le Sud tantôt vers l'Est et la côte, par exemple vers le Fort Monroe, situé tout près de ce Yorktown cher à l'amitié franco-américaine, Rochambeau, Lafayette avec Washington contre Cornallis ; tantôt vers l'Ouest pour y analyser les possibilités d'améliorer la navigabilité du Mississippi et de l'Ohio. Elle comprendra aussi une phase de supervision pédagogique, avec la mise au point du programme d'études de West Point et l'embauche de professeurs, comme avec l'étude du projet d'une « sorte d'Ecole polytechnique », nous en avons parlé à propos de Claudius Crozet et d'Auguste Comte.
Elle le conduira aussi, de plus en plus souvent, à fréquenter l'élite politique et militaire de son pays d'adoption, de plus en plus adopté précisément, avec respect puis affection - sans pour autant négliger la petite communauté française, surtout après le décès de Napoléon, quand on ne pourra l'accuser d'arrière-pensées. Elle lui permettra ainsi, mêlant l'analyse pointilleuse du terrain et les conversations multiples, de connaître presque tous les Etats-Unis de l'époque et de fréquenter toutes sortes d'Américains, pionniers incultes comme planteurs fortunés, intellectuels bostoniens, entrepreneurs ambitieux, avocats attirés par la spéculation intellectuelle ou les projets politiques. Il écrira des lettres sur les Etats-Unis et leur évolution -dommage qu'il n'ait pas eu l'occasion d'aller plus loin dans l'expression synthétique d'une pensée certainement réfléchie. Il se posera aussi la question de l'application, à la France, du modèle américain.
C'est peut-être aussi pour cela, l'espoir d'un progrès dans la gestion politique de la France, qu'il y rentrera après la Révolution de 1830 et le relèvement du drapeau tricolore. Ou pour payer sa dette à l'Ecole polytechnique dont ses élèves - ses tout jeunes camarades - ont joué un rôle important sur les barricades. Peut-être aussi parce qu'il subit toujours l'influence de La Fayette qui se rêve en parrain du nouveau régime. Ou, tout simplement, parce qu'il a le mal du pays et veut montrer à ses enfants, ce qu'est la France, ce qu'est Dole.
Donc, Bernard débarque en France, au Havre. J'emprunte au livre de Guy Scaggion, nourri aux meilleures sources de la médiathèque de Dole, quelques anecdotes et quelques commentaires sur le glorieux retour de l'enfant du pays dans les montagnes du Jura.
« Ses concitoyens ne l'avaient pas oublié. Prévenus de son retour, ils avaient décidé d'accueillir dans l'enthousiasme ce général qui avait su porter si haut et si loin la renommée de l'âme jurassienne. Malgré la neige et le froid, toute la cité était en fête et s'était portée au devant de lui.
La rencontre a lieu en haut de la colline du Mont Roland. Derrière la musique qui ouvre la marche, suit un détachement de la garde nationale parmi lequelle, il reconnaît avec émotion son vieux père qui est alors lieutenant des pompiers. Les retrouvailles sont l'occasion de fortes congratulations et d'effusions partagées. Les discours traditionnels échangés, c'est en cortège qu'il fait son entrée dans la ville au son du canon et acclamé par une foule en joie. A l'hôtel de ville, la municipalité lui a réservé un banquet digne de sa grande notoriété.
Nous pouvons imaginer le bonheur et la gaieté qui animaient les convives lesquels furent diserts en louanges, chants patriotiques, poèmes déclamés en l'honneur des mérites du héros dolois.
Bernard, dans la simplicité qu'il sut conserver toute sa vie, retrouva avec ses compatriotes les signes de l'affection qu'il leur témoignait bien des années auparavant, avant la grande aventure de la construction du nouveau monde. Il lui plaisait de parcourir la ville et ses environs, retrouver tous ces endroits tristes ou heureux dont sa mémoire gardait un fidèle souvenir. Partout où il passait, les gens l'accueillaient avec amitié, des attroupements se formaient dans les rues et son nom retentissait comme une salve d'honneur : « vive le général Bernard ». Pendant quelques temps, il se laissa bercer par cette ferveur populaire et les nombreuses marques de sympathie voire d'enthousiasme. Dans les écoles qu'il visitait, il était l'objet d'une admiration sans limite : prestige de l'uniforme, des actions, des succès scolaires. Il ne manqua pas de se rendre à la bibliothèque où le conservateur lui avait réservé un manuscrit de l'abbé Jantet. Le général redevint quelques instants le jeune Simon. Il prit le manuscrit avec émotion, le baisa et s'écria :
« Oh, excellent homme ! C'est à ses leçons seules et à l'exemple de ses vertus que je dois tout ce que je suis » ».
Après l'émotion du retour au bourg natal, ce sera l'épreuve (glorifiante mais sûrement moins agréable) du retour aux premières places de la hiérarchie militaire (tout ceci se fait dans les règles, avec une requête officielle présentée en personne au général-président Jackson pour qu'il le libère de ses obligations américaines : quand on s'appelle Bernard, on ne se comporte pas comme un stagiaire - apprenti - professionnel - footballeur qui veut changer d'équipe en tapant du pied).
Le travail qui l'attend après départ des Amériques et réintégration dans le « Corps Royal du Génie » porte à nouveau sur les fortifications ; puis, en deux épisodes successifs, c'est la charge de Ministre de la guerre qu'il lui faut assumer. Il essaie de rester « ministre technicien », se tenant éloigné autant que faire se peut des intrigues partisanes et davantage préoccupé de l'organisation des armées, des fabrications d'armes, des travaux aux frontières et - puisque c'est l'époque - de la conquête et de l'administration de l'Algérie.
La chute du Ministère Molé mit fin à sa charge ministérielle, qu'il vécut davantage comme une charge que comme une joie. J'aime à ce propos une anecdote de haut vol, tirée du Livre du Centenaire. Le fils du général avait été reçu à l'X, sous le prénom de Charles Auguste et non celui de Colombus que Bernard lui avait donné aux Etats-Unis à sa naissance, en 1920. Mais, ayant peu travaillé, il figure dans les derniers du classement de sortie. La direction de l'Ecole, conformément aux règles de l'époque, et sans doute avec un malin plaisir à la perspective de ce qui allait se passer, propose au ministre-papa l'exclusion de quelques élèves, dont Colombus. L'histoire ne dit pas ce que fut la température de la table familiale en ces journées, mais elle rapporte que le Ministre-ministre refuse le diplôme au fils. Bravo pour le père ! Mais le garçon, peut-être surpris, décide de repasser le concours, le réussit et revient à l'Ecole. Bravo pour le fils !
J'ai évidemment souhaité vérifier cette anecdote dans les archives de l'Ecole polytechnique. Une première analyse, rapide, des anciens élèves dénommés Bernard ne m'a pas donné de « Colombus » correspondant à la période vraisemblable de sa présence. Pas de Colombus, et pourtant, c'est bien le prénom que Simon avait donné à son fils, lors de sa naissance à New-York en 1820. Un examen plus attentif, effectué par mes amis des archives de la Bibliothèque, m'a mené au succès : le fils de Simon est repéré dans les élèves de la promotion 1840 sous les prénoms « Maximilien Charles Colombus ». Il a été reçu en bon rang ( ? ? ? ? 170), et ce n'est pas étonnant puisqu'il « a déjà été élève». Sa conduite est notée comme ... dissipée » (« a excité les élèves de la deuxième division au désordre »).
Le père eut certainement à souffrir des foucades du fils. Celui-ci, vers la fin de sa vie (1896) dira toute l'affection qu'il portait à papa, maman, et son évocation de la «vie américaine » de la famille, rapportée par Madame Françoise Planchot-Mazel, confirme la qualité des relations entretenues ou des personnes reçues par Simon : nous retrouvons dans cette longue liste les frères Lallemant, Lefebvre-Desnouettes, « les Bonaparte », de Tocqueville, Michel Chevalier, - pour ne parler que des noms cités dans mon travail.
Simon Bernard mourut le 5 novembre 1839, il avait été atteint d'une grave affection du larynx (un cancer ?). Il fut enterré au cimetière de Montmatre. J'ai été saluer sa dépouille ; 32ème division, première ligne, numéro 30. Elle est aujourd'hui signalée par une de ces guérites dont l'art funéraire était parfois friand, guérite pour poste de garde ou pour cerbère, élément éventuel d'une forteresse. Je ne sais pas ce que ce grand spécialiste du génie peut penser de ce genre de construction...
Lorsqu'il apprit ce décès, le président des Etats-Unis de l'époque, Van Buren, décréta pour les officiers américains un deuil de 30 jours : c'était là une noble manière de rendre hommage à une exceptionnelle tâche menée sans répit, pendant quatorze ans, au profit des Etats-Unis : des fortifications restaurées ou construites ; des chantiers de canaux multiples, avec tunnels, plans inclinés, viaducs ; un système d'enseignement à West Point digne de l'Europe ; un plan de lutte contre les dévoiements du Mississippi.
Avec une envergure bien supérieure à celle du très jeune Buisson (23 ans en 1816), d'emblée installé dans une position plus importante que celle du jeune Crozet (27 ans à la même date), Bernard (encore bien jeune, 37 ans) aura donc réussi une exceptionnelle carrière américaine entre deux périodes françaises déjà hors du commun, sur les champs de bataille puis dans des responsabilités ministérielles. Encore plus que Crozet et beaucoup plus que Buisson, il aura fourni aux Américains une belle image du comportement et du savoir-faire...dois-je dire «des Français»? ou des «polytechniciens»? Cela vaut la peine de développer ce point. Ce sera fait dans un instant, le temps pour le lecteur de lire, et pour moi d'écrire cette notation mélodiquement harmonieuse : dans la bibliothèque que Bernard a constituée, et dont il dresse la liste précise en rédigeant son testament en 1825 (en anglais), figurent des Rabelais et des Racine. Mais aussi les voyages de Bougainville (le père). Et aussi, « The American Ornithology », celle de Wilson, celle-là précisément que complétait à l'époque notre ami Charles-Lucien Bonaparte. Simon Bernard savait repérer les beaux livres édités à Philadelphie et tirer parti de ses conversations avec le prince ornithologue.

